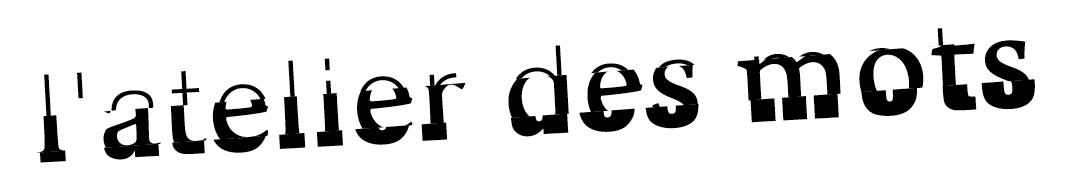jeudi 11 juin 2009
Le cimetière
Paul referme la lourde porte en fer, s’avance d’un pas assuré vers un tombeau choisi d’instinct, une marguerite à la bouche. De son briquet, il brule la lettre d’amour qu’il a écrite la nuit dernière à cette inconnue. Il ouvre discrètement le tombeau. Il a envie de sexe. Il se soulage. Il rit. Demain il en choisira une autre.
Rêve
Cette histoire vécue mais qui n’est pas vraie, dont on se souvient et qui n’a jamais eu lieu, ce moment qui s’étend sur des heures mais qui n’a duré qu’une seconde.
Ce sentiment senti mais jamais ressenti, ce monde de tous les possibles encré dans le réel, où l’Homme est dieu et ne décide de rien.
Ces instants où l’on voyage étendu, où l’on est soi-même sans vraiment l’être, ce passé qui n’en est pas un.
C’est un rêve.
Carla Bruni
Elle que toutes les femmes envient,
A qui la vie a sourit,
Jamais n’a été démunie,
Jeune et belle, bien plus que jolie.
Elle que les hommes veulent dans leur lit,
Prête à relever tous les défis
Elle a récupéré Nicolas le petit
Abandonné par Cécilia la honnie,
Et par la main elle l’a pris
Puis à l’Elysée l’a suivi.
Elle qui a vécu milles vies,
Première dame, chanteuse et égérie
De grandes marques de l’industrie
De la mode, du textile et des fantaisies.
Elle qui a fait toutes les folies
Qui a des enfants on ne sait pas de qui
Un père, un fils et pourquoi pas un Saint Esprit.
Voilà son dernier exploit inédit,
Celui que jamais je ne pensai qu’elle réussit :
Ma feuille toute noircie
Qui parle de la Bruni !
Ecrire pour moi c'est
Ecrire pour moi c’est protéger cette petite feuille innocente et sans défense, lui donner la vie à travers le souffle de mes mots, l’enlacer de mes lettres rondes, la guider au fil de mes phrases, l’emplir de la force de mes points et la laisser enfin prendre son envol dans mes accents aériens.
Ecrire pour moi c’est comme draguer la plus belle du village, cette feuille adolescente devant qui ont frimé poètes et écrivains, espérant la retenir avec leurs histoires, leurs rimes, sans jamais n’obtenir d’elle qu’idylles sans lendemain.
Ecrire pour moi c’est comme coudre une robe de soirée pour dame feuille. C’est l’habiller de couleurs, de sentiments, d’histoires, de fantaisies et de rêves. C’est enfiler l’aiguille de mon imagination à travers les mailles des mots pour lui coudre sur-mesure, le texte dans lequel je l’ai rêvée.
Ecrire pour moi c’est braver le froid des neiges éternelles qui étale peu à peu son manteau blanc sur la vielle feuille palie. C’est réchauffer son corps froid de ma chaleur du sud, de mon tempérament méditerranéen, de mon exotisme oriental, et barioler la neige des teintes ocres et chaudes de mes sentiments.
Ecrire pour moi c’est continuer alors même que la regrettée feuille est pleine de mots. C’est en trouver une autre et recommencer…
Où et comment aimeriez-vous mourir ?
Certains sont morts dans leur lit, d’autres au combat,
Certains sont morts nés et d’autres centenaires,
Certains l’ont choisie, d’autres ne l’ont pas vu venir,
Certains ont crié, d’autres se sont tus,
Certains ont pleuré et d’autres ont souri,
Certains ont fermé les yeux, d’autres les ont ouvert,
Certains étaient assis, d’autres allongés,
Certains étaient connus, d’autres anonymes,
Certains en étaient certains et d’autres ne l’étaient pas,
Certains sont mort lentement, d’autres ont été foudroyés,
Certains c’était leur faute, d’autres celle des autres,
Certains c’était trop tôt et d’autres trop tard,
Certains étaient soulagés, d’autres étaient embêtés,
Certains c’est arrivé et d’autres c’est à venir…
Et moi ? Je veux être de ceux qui l’écriront, dans leur lit, centenaires, qui ne la verront pas venir, qui se tairont, qui souriront, qui fermeront les yeux, allongés, anonymes, qui ne seront pas certains, foudroyés, dont ce sera la faute… des autres, et ce sera trop tôt, qui seront soulagés, et pour qui c’est encore à venir.
Vous êtes un tueur professionnel. Que prenez-vous au petit déjeuner ?
Age : 34 ans
Poids : 90kg (de muscles)
Teint : Basané
Cheveux : Noir
Yeux : Noir
Signe distinctif : Cicatrice à la main droite
Arme de prédilection : Couteau
Comme tous les jours, à 5h30 du matin, SC ouvre ses yeux noirs sur les murs blancs de sa chambre. D’un bond, il saute du lit, se dirige vers la salle de bain où il se lave le visage à l’eau claire, comme on lave un pêcheur de ses mauvaises actions, un accusé de tout soupçon. Lui n’arrive à laver que son visage, l’image de sa victime de la veille encore dans sa tête.
Une heure durant, il alterne dans sa salle de gym course et port de ferraille, pour se tenir en forme dit-il. On l’entend grogner lorsque l’effort est trop dur, souffler lorsque la course est trop longue.
A 6h45 pile, comme tous les matins, il prend un couteau, pas celui encore sale du sang de sa victime de la veille, et étale la confiture de fraises rouge sur une tranche de pain complet. Ce pain, il l’achète toutes les semaines chez le boulanger au bout de la rue qui le fait spécialement pour lui : sept sortes différentes de céréales, pas de farine, et cuisson pendant trois heures au four à bois. La confiture est envoyée toutes les deux semaines par sa mère qui la lui fait elle-même.
Il lève le bout de pain vars sa bouche comme il soulève ses victimes au moment ultime, le croque et le broie et finalement le déchiquette de ses dents comme il déchiquette ses proies de se son couteau. Le repas fini, il lave son assiette, le couteau plein de confiture ainsi que celui plein de sang avant d’enfiler ses vêtements, de prendre son couteau et de quitter sa maison, à 7h30 précises. Il se dirige vers son laboratoire, où il commet tous ses meurtres.
SC, Sylvain Cossette est chercheur en biologie cellulaire. Tous les jours il tue des souris et conduit des expériences sur leurs cellules.
Gitanes
Assise au pied d’un escalier, presque sur le trottoir, une belle gitane aux longs cheveux noirs frappait avec frénésie sur un instrument à percussions. Elle frappait fort, elle frappait vite. Le son de son instrument semblait se perdre dans l’activité incessante de la rue. Je m’arrêtai un instant et la regardai. Elle était comme en transe. Fasciné par l’énergie qu’elle dégageait je m’assis sur le trottoir opposé de la rue étroite et la détaillais. Un fichu à motifs bleus et rouges empêchait sa crinière brune de lui cacher le visage. Au haut de sa joue droite, quelques tatouages qui ressemblaient à des scarifications reliaient le visage rond à l’oreille portant deux boucles créoles et un plume violette. Sa bouche était grimée d’un rouge sang, qui, si elle n’avait pas été aussi belle, m’aurait fait penser à un vampire. Je vis que ses lèvres bougeaient, comme si elle murmurait, ou accompagnait son instrument d’une chanson. De là où j’étais, je ne pouvais pas entendre ce qu’elle disait. Ses yeux, d’un bleu si pale que je me demandai si elle était aveugle, étaient soulignés de noir. Son regard était fixé sur ses mains qui battaient le cuir usé mais mélodieux de son instrument. Le caisson rouge vif de l’instrument était coincé entre deux jambes cachées par une grande robe aux multiples motifs bleus sur fond violacé.
Tout à coup, elle se mit à frapper plus fort. J’étais ébahi par son énergie et la fixai du regard. Une foule de personnes passa dans la rue entre nous et je la perdis de vue un bref instant. Quand elle réapparut, le son de son instrument avait repris son intensité habituelle. Peu à peu, elle accéléra le rythme, et deux enfants passèrent en courant. Plus le rythme accélérait, plus j’avais l’impression que les enfants courraient vite. Quelle coïncidence… Mais en était-ce vraiment une ? L’idée m’effraya et je l’éloignai aussitôt de mon esprit. Je regardai tout de même la gitane l’air interrogateur. Elle ne leva pas la tête, occupée à jouer de son instrument et à murmurer, mais un instant, j’eus l’impression qu’elle me souriait. Elle frappa à nouveau quelques coups accélérés, et une femme qui poursuivait son mari, une casserole de cuivre à la main traversa la rue à toute vitesse.
Je ne m’étais pas fait d’idée. C’est à ce moment que je me rendis compte que les murmures de la femme emplissaient mes oreilles. Elle prononçait des paroles incompréhensibles, comme une langue venue de l’autre bout du monde, à laquelle je ne comprenais rien mais qui semblait si belle, si mélodieuse à mes oreilles. Elle n’était pas gitane mais sorcière, et pour moi, il était trop tard. J’étais déjà sous le charme. A ses paroles envoutantes, vient s’ajouter la musique d’un instrument à cordes. Je levai les yeux et vis que derrière la gitane, se tenait une autre femme, jouant d’un instrument qui, sans être une guitare, y ressemblait fortement. Sa chevelure rousse flamboyante, soutenue par une pince couleur argent, était relevée plus haut que ses épaules dénudées. Seules quelques mèches échappées de la masse de feu chatouillaient le haut de sa poitrine cachée par un bustier aux différents tons orangers. Une jupe bleue nuit paraissait prendre racine dans l’instrument ocre pour descendre jusqu’au sol en formant de multiples plis. Son visage, bien moins maquillé que celui de la gitane assise à ses pieds, avait l’air bien plus jeune. Un peu de rose sur ses lèvres, du bleu clair sur ses paupières pour souligner le vert de ses yeux suffisaient à la rendre éblouissante. Dans mon émoi, je remarquai qu’elle possédait les mêmes tatouages que l’autre gitane, sur le haut de sa joue droite. L’ombre des nuages qui défilaient au rythme des cordes pincées faisait briller en un jeu d’ombres chinoises les multiples bagues autour de ses doigts. Incapable de bouger, je ne savais plus où donner de la tête.
Sur le même escalier, deux marches plus haut, une troisième femme s’installa sur un tabouret et se mit à jouer de la harpe. Je ne sais plus ce que je vis en premier, la blancheur de sa cuisse ronde, dévoilée par la fente de la jupe verte, ou la candeur de son visage d’enfant, auréolé de boucles brunes. A part le pourpre de ses lèvres et les scarifications de la joue droite, rien ne venait masquer le naturel éblouissant de son visage. Son cou était enchainé de mille chaines d’or qui venaient se perdre dans la fente entre ses deux seins naissants. Elle portait une tunique ample, d’un blanc presque virginal, laissant entrevoir de temps à autre quelques bouts de chair encore rose. La jupe d’un vert pomme accrochée bien bas sur ses hanches et tombant jusqu’à ses chevilles était fendue sur presque toute la longueur, découvrant une cuisse ronde, ferme et blanche. Dès que les premières notes s’élevèrent de sa harpe dorée, un sentiment de bien-être envahit l’espace et le soleil inonda la rue toute entière.
Au milieu, à l’endroit le plus lumineux, une gitane blonde à la peau brune drapée d’un seul tissu bariolé de couleurs vives se mit à danser. Je ne vis pas son visage, caché par les mèches blondes qui virevoltaient dans tous les sens, mais devinai qu’elle devait avoir le même tatouage à la joue droite que les autres femmes. Elle semblait faire un tout avec la musique, le drap aux milles couleurs, les mèches qui s’envolaient dans tous les sens, ses pieds nus frappant le sol noir, et les bracelets de fer qui s’entrechoquaient à ses poignets. Elle se déhanchait, comme possédée par la musique. Elle était énormément belle. Je m’imaginai me lever, aller vers elle, lui prendre la main, la faire tourner, danser avec elle, mais j’étais incapable de bouger. Je fermai les yeux, et dans le noir intense, vis les quatre femmes me sourire, m’envoyer un baiser de leurs mains.
J’ouvris les yeux, elles n’étaient plus là. La musique avait disparu. Les enfants qui courraient avaient atteint la fin de la rue, la femme qui poursuivait son mari l’avait assommé de sa casserole en cuivre, et maintenant le réanimait avec de l’eau. Les piétons passaient au dessus de mon corps étendu sur le trottoir en me lançant des jurons.
L'attente
Mais de son coté, lui ne le saura jamais, puisque pas une fois, il n’essayera de l’appeler.
Un dos tourné
Voilà ce qu’elle a mimé
Toute de noir habillée
Je viens de le remarquer,
Ce qui n’a rien arrangé.
Son geste sans gaité
De tout mouvement dénué
Est resté
Tel qu’elle l’a commencé
Inanimé.
Non inspirant,
Barbant
Sans aucun changement.
Elle se défend
A tout moment
De faire un quelconque mouvement.
Mais je me répands
En arguments
Pour décrire un enfant
Absent.
Page blanche
Elle mâche
Je mâche. Je mâche. Je mâche de plus en plus fort. Je mâche tellement fort qu’on m’entend mâcher jusqu’au bout de la rue. Non, ce n’est pas assez ! Allez, je veux qu’elle sache que je mâche. Elle voulait que je mâche, eh bien voilà, JE MACHE ! Et puis quoi ? Je ris fort. Si elle croit que je ne peux pas rire parce que je mâche, elle se trompe ! Oui, je mâche et je ris ! Ca va la mettre hors d’elle, je le sais. Je mâche, tu entends ? Je mâche ! Viens seulement, maman, que je te crache à la figure ce repas que tu voulais tant que je mâche !
Le café
La minuscule cuisine de cinq mètres carrés à peine, remplie de placards et d’ustensiles au milieu desquels on peut à peine se mouvoir est vide. Vide de toi, vide de ces bijoux que tu as portés ce matin, prenant bien soin de ne me laisser de cette nuit passée ensembles qu’un souvenir immatériel qui s’effacera peu à peu de ma mémoire, la laissant vide, vide comme la cuisine dans laquelle je me tiens. Pas même un mot pour dire merci, ou une tasse de café dans l’évier, preuve que je n’ai pas rêvé. Rien.
La cafetière siffle, et je me dis que j’aurais aimé que tu sois resté. J’aurais voulu entendre tes mots sucrés couler dans mon café, ce café qui brule pendant que la cafetière siffle et que je pense à toi. Ais-je rêvé ? La cafetière siffle. Oui ? Non ? Le café brûle. Le vent souffle, la cafetière siffle, je pense à toi, le vent souffle, le café brûle, la fenêtre claque.
Je reprends mes esprits. Je suis là, sur mon lit. Tu entres dans la chambre, le café à la main. Tu es là, tu n’es pas parti. Tu me tends le café, ce café fait dans la cafetière qui sifflait, mais qui, lui, n’a pas brûlé !
Justice
Il y a bien longtemps, un peuple qui aujourd’hui n’a plus de nom, de lieu ni même de date d’existence, un peuple oublié, vénérait, parmi ses nombreux dieux, la déesse Justice. Justice était princesse chez les dieux. Fille de Suprême, le roi des dieux, elle avait un frère et une sœur, Courage et Noblesse. Justice était belle, jeune et, même s’il lui était arrivé de sévir, de tuer même quelques fois, elle avait encore le cœur pur. Elle venait d’un monde où les idées, ce que nous appelons aujourd’hui les valeurs, étaient absolues et elle ne comprenait pas pourquoi le sol sur lequel elle marchait était tantôt noir, tantôt blanc. Elle n’aimait pas les zones noires. Dès qu’elle s’y trouvait, l’animal en elle se réveillait, elle brandissait son épée et prise de fureurs, donnait des coups, blessant ou tuant les âmes qui s’y trouvaient. Les zones blanches étaient, par contre, bien plus agréables. Elle y aidait les méritants et s’y plaisait bien.
De temps en temps, son épée glissant de sa main tombait, écorchant au passage quelques âmes « innocentes » et sa robe blanche se tachait d’un peu de gris, ce qui la mettait fort en gène lorsqu’elle se rendait à la cour de son père.
Justice aimait la cour Suprême. Le sol y était tout blanc et les dieux qu’elle rencontrait étaient pleins de qualités. Elle recevait souvent des compliments à propos du travail accompli (bien qu’elle ne considérait aucunement qu’elle accomplissait un quelconque travail), ou de son accoutrement. Celui-ci était assez simple : une robe blanche, de temps en temps tachetée de gris, une épée qui ne quittait pas sa main droite, une balance lui servant à peser le pour et le contre dans sa main gauche et une coiffe trônant sur sa tête. Elle n’aimait pas beaucoup sa coiffe. Elle était lourde et manquait de beauté. Justice n’avait jamais osé l’enlever, depuis ce jour où, à la nuit des temps, son père l’avait faite princesse en prononçant les mots suivants, gravés à jamais dans sa mémoire :
« Justice ton nom sera
L’épée juste tu porteras
D’une balance tu pèseras
De la guerrière, la coiffe tu ne quitteras
Avec conscience ta tâche tu accompliras. »
Ces mots restaient un mystère pour Justice. Guerrière ? Tâche ? … Mais cela faisait bien longtemps qu’elle avait cessé de se poser ces questions.
Les temps passèrent et le peuple sans nom tomba dans l’oubli. Justice continuait sa vie sans se rendre compte que les dieux changeaient. Ra et ses dieux à tête d’animaux combattirent le dieu unique d’Akhenaton, Zeus et ses semblables se battirent contre les Géants, Jupiter courtisa Vénus, au dieu de Moïse s’ajouta celui de Jésus suivi de celui de Mahomet, Allah, chacun d’eux s’accoquinant de temps en temps avec Bouddha et ses semblables.
Sans qu’elle ne se rende compte, Justice se retrouva un jour les yeux bandés. Elle ne pouvait pas voir que dans sa main gauche les livres des Hommes remplaçaient désormais la balance des dieux, que son épée se couvrait du sang coagulé des âmes tuées, que sa robe n’avait plus du blanc que le souvenir. La seule chose dont elle pouvait se rendre compte était que sa coiffe de guerrière pesait de plus en plus lourd. Justice ignorait même qu’elle avait des représentants chez les Hommes qui ne représentaient rien d’autre que leurs propres intérêts.
C’est à se demander si la justice doit vraiment être aveugle.
Ma ville
Comme un enfant mal éduqué, aujourd’hui tu renies
Ton histoire, ton passé, ton âme, ton identité.
Toi, ville de mon enfance, celle où j’ai grandi,
Je voudrai que tu prennes conscience de tout ce qui se dit
A ton propos dans le cœur d’un des enfants de ton malheur.
C’est avec dédain qu’aujourd’hui je m’adresse à toi
Toi dont l’odeur me met en émoi
Me renvoie toujours à moi, moi enfant, moi avant.
Dans ton sable j’ai joué, sur tes pierres me suis blessé,
Tes couleurs j’ai contemplé à tout moment de la journée
Le matin, la nuit tombée.
Je t’ai fait toutes mes confidences
En toi j’ai mis ma confiance
En toi j’ai perdu mon enfance
Pourquoi ? Me retrouver entouré de tant de souffrance.
Moi qui rêvais pour toi d’un avenir parfait, des journées durant j’ai écouté
Cette musique métallique que chantaient le nombre incalculable de chantiers
Qui mon passé ont peuplé et ton avenir ont volé.
Mais une fois loin de toi, ton enfant
S’est langui de ton soleil étouffant
De ton tapage incessant, assommant, agaçant,
De la cohue des gens déments
Qui peuplent tes appartements.
Et l’enfant un jour parti est finalement rentré au pays.
Une fois passée l’euphorie de ce retour de banni
Il a retrouvé ton ciel
Autrefois plein d’étoiles et de merveilles
Peuplé d’immeubles résidentiels.